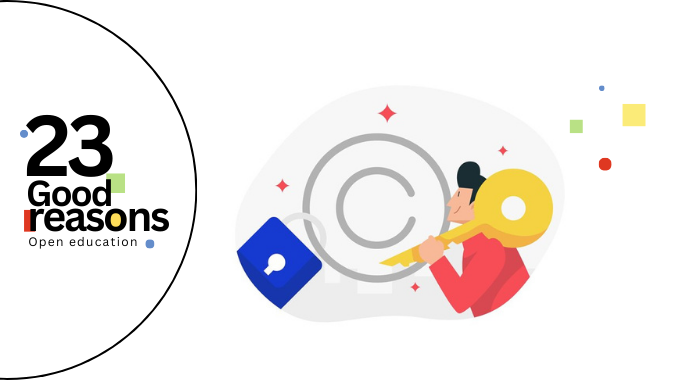
Auteur
Jacques Dang occupe plusieurs postes dans le monde francophone en rapport avec l’éducation ouverte. Il est actuellement secrétaire général du conseil d’administration de l’Université Numérique, en France.
La défense des droits de l’auteur sur son œuvre est un débat de société qui resurgit au gré de l’actualité : pour recommander, un jour, une ouverture complète et gratuite des œuvres comme des biens communs de l’humanité, le lendemain, pour prôner l’interdiction de leur usage pour entraîner des outils d’intelligence artificielle.
Ces différences d’approche ne sont pas nouvelles. Dès le XVIème siècle, des solutions divergentes ont pu apparaître, avec l’octroi en 1557 au Royaume-Uni du monopole de reproduction d’œuvres à une guilde d’imprimeurs, pour des raisons politiques de censure, tandis qu’en France, Ronsard obtient en 1554 un privilège royal, personnel et à durée illimitée, valable pour toutes les œuvres, déjà publiées ou à venir, dont il est l’auteur.
Ces différences vont s’enraciner avec l’émergence de deux systèmes juridiques majeurs dans le monde : le droit civiliste, dérivé du droit romain, et la « common law » des pays anglo-saxons, et leur impact sur le régime de protection des œuvres :
- Pour les pays de droit civiliste : la protection des droits de l’auteur d’une œuvre, ancrée dans la propriété intellectuelle
- Pour les pays de common law : le copyright, réglementation qui encadre le monopole de la reproduction des œuvres
Différences renforcées par la place du contrat (qui met en œuvre le droit d’auteur ou le copyright) dans la hiérarchie des normes de droit de chacun des deux systèmes juridiques (après les normes de droit public pour le droit civiliste, quasiment sans hiérarchie pour la common law).
Cartographie des pays de droit civiliste et des pays de common law
Ces divergences produisent dans un premier temps des effets limités, dans la mesure où ces systèmes juridiques s’exercent sur un territoire limité géographiquement, celui de chaque pays.
Mais avec le développement du commerce international, la nécessité de rapprocher les régimes juridiques pour obtenir des règles homogènes au niveau international va s’imposer progressivement dans les esprits.
C’est ainsi que la Convention de Berne de 1886 permet un début d’harmonisation, même si les États-Unis n’y adhèrent qu’un siècle plus tard, en maintenant leurs réserves sur le droit moral des auteurs. Cette convention et les accords internationaux qui la complètent visent à harmoniser le traitement du droit d’auteur et du copyright à travers le monde en convenant d’un ensemble de protections minimales qui devront être intégrées à la législation nationale de leurs signataires. Les accords internationaux sont négociés, convenus et signés par des pays. Ces accords engagent donc des pays et non des individus.
En règle générale, ces traités internationaux ne déterminent pas précisément la législation en vigueur dans un pays. Ce sont les États ou les groupements d’Etats (Union Européenne, Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle…) qui édictent leur législation en la matière. Les individus doivent respecter leur législation nationale sur le droit d’auteur.
Avec l’émergence du numérique, qui produit une rupture comparable à celle de l’imprimerie et Gutenberg, le contrat de licence devient une réponse adaptée aussi bien dans les pays de droit d’auteur que dans les pays de copyright. C’est un contrat de droit privé entre un ou plusieurs auteurs et un ou plusieurs utilisateurs.
Pour ouvrir largement l’accès à leurs œuvres, les auteurs peuvent avoir recours à des contrats de licence ouverte, qui au-delà de l’usage gratuit de l’œuvre, peuvent accorder à l’utilisateur des permissions additionnelles, comme rediffuser l’œuvre, la modifier ou la traduire.
La situation en France et dans les pays de droit civiliste
Dans les pays de droit civiliste comme la France, le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre de la protection de la propriété littéraire et artistique, une des deux branches, avec la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle. Les contrats de licence, s’inscrivent dans la hiérarchie des normes de droit, qui place le contrat au-dessous de la constitution, des traités internationaux, de la loi et du règlement.
L’auteur bénéficie donc de la protection assurée par chacun de ces niveaux de normes de droit, que ce soit sur ses droits moraux (prérogatives de respect de l’auteur, de l’œuvre et du lien indissoluble entre l’auteur et son œuvre) ou sur ses droits patrimoniaux d’exploitation de son œuvre. Dans la plupart des pays de droit civiliste, les droits moraux sont perpétuels, imprescriptibles, inaliénables et d’ordre public : l’auteur peut renoncer à un moment donné à exercer ses droits moraux, mais cette renonciation ne l’engage que jusqu’au moment où il change d’avis.
Cette protection s’impose contre des clauses de contrats de licence contraires au droit des contrats (contrat de durée illimitée, par exemple) ou au droit d’auteur (contrat ne permettant pas l’exercice du droit moral de retrait d’une œuvre). Néanmoins, si l’œuvre est mise à disposition sur une plate-forme numérique d’un pays de common law, ces protections ne peuvent être invoquées devant la juridiction du pays que si elles figurent explicitement dans le contrat de licence.
La protection juridique des droits de l’auteur est donc bien assurée dans les pays de droit civiliste. La mise en œuvre technique de cette protection et la compensation économique des manquements à cette protection sont peut-être plus fragiles.
Licence
Cet article de Jacques Dang est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Poster un Commentaire